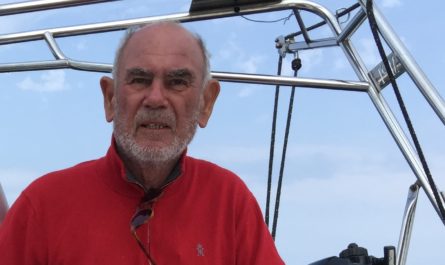C’est un des problèmes majeurs de la démocratie en France : les différents partenaires, quels qu’ils soient, ne se parlent pas ou seulement pour échanger des noms d’oiseaux. C’est vrai entre partis politiques, en particulier au Parlement où il suffit qu’une proposition soit avancée par tel ou tel pour qu’immédiatement toutes les autres formations la vouent aux gémonies. Il n’y a guère qu’au niveau local (par exemple les communes) qu’un certain consensus apparaisse – mais pas toujours.
La même chose sur le plan social : syndicats et patronat ont toujours beaucoup de mal à se mettre d’accord comme le montre l’exemple récent de la nécessaire réforme des retraites. Il a fallu six mois de négociations pour que l’âge limite de retraite passe de 67 ans à 66 ans et demi. Des progrès importants ont été faits sur les retraites des mères et sur d’autres sujets, mais c’est une tradition de refuser de signer car trouver un accord, ou pire un compromis, est considéré comme une trahison à la classe ouvrière.
Donc tout le monde se tourne vers l’Etat pour que ce soit lui qui tranche et prenne la responsabilité des décisions, ce qui permet ensuite de le critiquer. Dans le cas des retraites, ce serait normal qu’elles soient gérées par les deux partenaires puisque les financements viennent des travailleurs et des employeurs.
Il faut dire que la méthode Bayrou de discuter ad libitum, de reporter les choses, d’intégrer la politique des retraites dans le projet de loi de finances n’inspire guère confiance.
Hésiter, reporter, procrastiner ne font pas une politique. Mais Bayrou sera- t – il encore là en juillet pour présenter la loi de finances ?